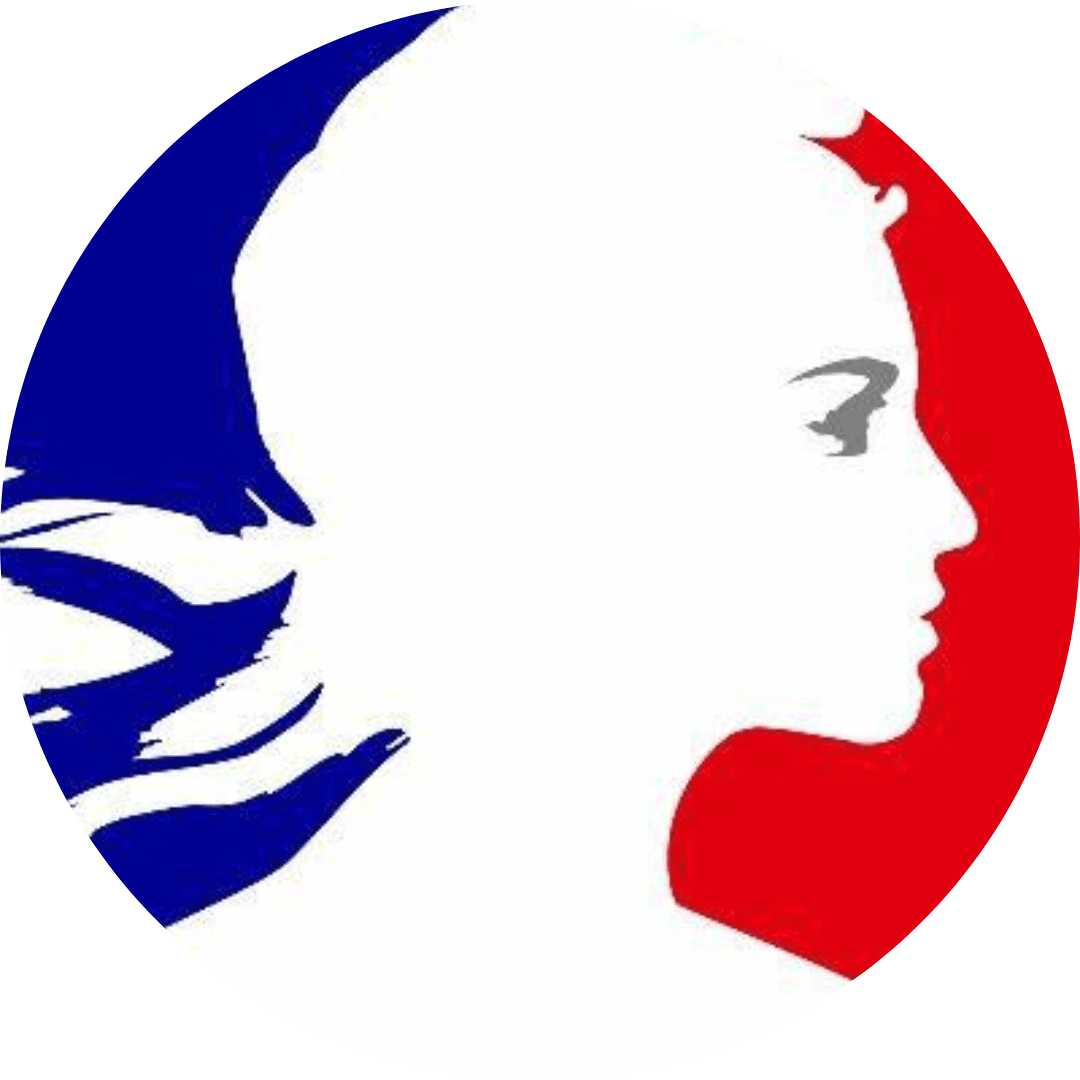Description des missions
Sujet de thèse :
Jusqu’à la détection de la première exoplanète autour d’une étoile autre que le Soleil en 1995, le système solaire était notre seul laboratoire pour comprendre la formation et la nature des planètes. Trente ans plus tard, plus de 6 000 exoplanètes ont été découvertes en orbite autour d’environ 4 500 étoiles, et ces systèmes montrent une diversité riche et inattendue. La plupart d’entre elles ont été découvertes en utilisant les méthodes de vitesse radiale (RV) et de transits. La détection des émissions radio provenant de systèmes exoplanétaires pourrait constituer une nouvelle méthode de détection d’exoplanètes, tout en fournissant des informations complémentaires jusqu’ici inaccessibles, telles que l’intensité du champ magnétique, la structure interne et les régimes des dynamos planétaires, la période de rotation, le verrouillage spin-orbite, les énergies d’interaction étoile-planète, et des contraintes possibles sur l’habitabilité des planètes.
Certains sursauts stellaires sont d’ores et déjà détectés dans le domaine radio à des fréquences ≥600 MHz, et proviennent de processus dynamiques ou éruptifs complexes dans les atmosphères des étoiles. Les fréquences radio plus basses permettent d’explorer les enveloppes stellaires externes, les éjections de masse coronale (CME) et divers autres processus d’accélération et d’instabilité. Les interactions étoile-planète et leurs émissions aurorales associées devraient quant-à elles produire des sources fortement polarisées circulairement à des fréquences de l’ordre de ~100 MHz via l’instabilité maser cyclotron (IMC). Mais seules les planètes de notre système solaire ont été étudiées en détails en ondes radio. L’IMC y produit des sursauts radio à large bande, de basse fréquence, intenses, anisotropiquement collimatés et entièrement elliptiques ou fortement polarisés circulairement (voir (Zarka, 1998) pour une revue).
Cette thèse vise à approfondir notre compréhension des environnements stellaires et des interactions étoile-planète grâce à l’étude de leurs émissions radio basse fréquence. En exploitant les relevés LoTSS-wide et LoTSS-deep réalisés par LOFAR à 120-165 MHz (Shimwell et al., 2017; Tasse et al., 2021; Shimwell et al., 2022), nous développerons des méthodes avancées pour détecter et analyser des sursauts radio stellaires, améliorant l’approche mise au point pour l’analyse des premières releases LoTSS DR1-2. Ces travaux permettront d’augmenter significativement la taille des échantillons étudiés et de mieux contraindre les propriétés des populations stellaires émettrices et les mécanismes physiques à l’origine de ces émissions. L’arrivée de LOFAR 2.0 en 2026 offrira des observations plus sensibles et à plus basses fréquences, élargissant les capacités d’analyse des émissions radio. Ces travaux prépareront l’exploitation du Square Kilometer Array (SKA) dès 2030, qui permettra une synthèse avancée des spectres dynamiques, ouvrant
Voir plus sur le site emploi.cnrs.fr...
Profil recherché
Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche pluridisciplinaire placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.C’est l’une des plus importantes institutions publiques au monde : 33 000 femmes et hommes (dont plus de 16 000 chercheurs et plus de 16 000 ingénieurs et techniciens), en partenariat avec les universités et les grandes écoles, y font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Depuis plus de 80 ans, le CNRS développe des recherches pluri et interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l’international. Le lien étroit entre ses missions de recherche et le transfert vers la société fait du CNRS un acteur clé de l’innovation en France et dans le monde.Le partenariat qui lie le CNRS avec les entreprises est le socle de sa politique de valorisation et les start-ups issues de ses laboratoires témoignent du potentiel économique de ses travaux de recherche.